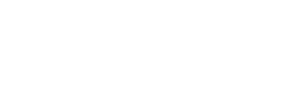– Je me réjouis de retrouver la ferme. Cette attente fut une douloureuse étreinte loin de nos terres, et loin de toi.
– Bonsoir, lâcha-t-elle, sèchement.
– Tu n’es pas heureuse de me retrouver, là où la guerre nous a odieusement séparés ?
– Tu vas pouvoir te rendre utile désormais. Maintenant que tu es là, je n’aurai plus de peine à rêvasser en attendant ton retour.
– Je n’avais plus de patience à voir le soleil baigner le versant de sa caresse, et les monts de mon Ariège découper l’horizon.
– C’était comment ?
– Quoi donc ? fit-il, éberlué.
– Le débarquement.
– Décevant, avoua le berger à sa bergère. Les notes sucrées de la lavande avait enivré mon esprit avant d’accoster sur la plage. J’avais même partagé aux camarades de la 148e mon désir de contempler les champs violets bercer la candeur opiniâtre des soirs d’août. Mais à Menton on ne voit guère de fleurs, il aurait fallu s’enfoncer davantage dans les terres, je n’ai rien vu de tout cela. Tu sais la trouille que j’avais en posant ma botte dans le sable, sapé à l’américaine ?
– Toi ? railla-t-elle. Je te connais trop gaillard pour avoir peur.
– Pourtant je tremblais de tout monde être, à faire vibrer la barge, et sur la plage, je tremblais encore.
– Et ma colère t’a sans doute fait trembler davantage de ne pas te savoir revenir.
– Tu t’es bien occupé du troupeau ?
– Les brebis n’ont d’autres tort que d’agneler avant que septembre s’abaisse. Elles ont davantage de griserie que moi la veulerie que ton absence m’a fait porter.
– Comme me manque le souffle âcre des pastorales dans la laine hirsute des agneaux. La mémoire de taraude. Dans mes pensées, je me vois encore marcher dans les sentier de l’alpage, et la horde des patous pourchasser la montagne. Tu as sorti le fourrage pour l’hiver ?
– Dans la bergerie.
– Et la récolte ? demanda-t-il, inquisiteur.
– Bonne mais sans abondance, je n’ai de miracle à espérer sans tes bras. Le fils des maraîchers y a fait bon apprentissage, il reviendra l’an prochain.
– Tu vois que tu sauras t’en débrouiller, dit le berger, apaisé.
– Bien sûr, c’est de moi que tu tiens l’enseignement, je t’ai tout appris. Il y a encore tant de choses que j’avais à t’éduquer.
– Je reviens avec confiance, tu sauras t’occuper.
– Voilà que les larmes me montent aux yeux, confia-t-elle, larmoyante. Les campagnes se vident, et je n’aurai d’autres entraide que la pâleur du soleil pour réchauffer les frêles aurores de l’automne ; tu es parti il y a si longtemps que j’ai peine à me souvenir de ton visage. Ta voix m’est celle d’un inconnu que j’embaucherai volontiers pour soutenir mes torts, et à mes déboires succomber ; bientôt je serai trop vieille pour administrer seule la ferme pour son tout. J’avais admis à ton départ que peut-être je ne te reverrai, et je ne te vois déjà plus. Tu es pareil à un reflet, un visage fantôme que le diable dévore : le visage, impassible retors, qui m’apparaît depuis la nouvelle funeste de l’impossible retour. Tu es mort sur la plage, et mon espoir avec toi s’est évanoui.