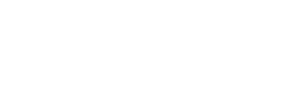On dit souvent qu’il n‘y a pas de fumée sans feu, mais pour le moment il n’y a même pas d’eau dans le puits.
Ma vie, il faut se l’imaginer couverte de flotte, mais jamais mouillée. Étrange ne serait que le début d’un pléonasme foireux, indécis, trépidant et barbouillé de sureau et d’érable. J’en ouvre alors une fiole avec ma bouche moite, encore saoule d’espoir et emplie de passion d’avoir enfin jeté l’encre.
Pattemouille à la main, j’essuie mon front ruisselant de liquide et je range ma flasque d’eau bénite dans la poche gauche de mon veston, un cuir souple de couleur bleu. Je me dis, avec un peu de recul que m’oblige à prendre le temps qu’il fait dedans, qu’on ne fait plus d’aussi doux cache-misère de nos jours, mais foutons le camp de ce rafiot moelleux, dont ma mémoire penche encore du côté droit du plumard et qui est de facto le plus imprégné par la pluie et la bouteille vide.
Suivi de mon vieux Trépas on attire à nous le petit ponton de bois. La calibration est tip top, mais je manque de me prendre dans la gueule un nœud en forme de papillon au moment clef de palpitations qui rejoint l’amarrage.
Normalement, à ce moment on place un taquet sur une surface adaptée à le recevoir pour s’inviter à dîner. Cependant, avez-vous déjà invité quelqu’un à mettre sa tête sous le niveau de la mer ? « Blup blup blop » que l’on entend si on s’en résume à Polochon. Imbibé de la sorte, c’est sensiblement plus difficile !
Mon bateau louche.
Tout le monde se tire et je marche. Je marche sur la route et je manque de glisser sur une éponge de mer foutue là par on ne sait qui, on ne sait comment, et on-ne- sait-pourquoi surtout. Triste matinée que voilà, mais on l’a échappé belle comme dirait l’adage des marins qui sont à cent mille verres de nous. Un courant froid me frôle les artichoques. Le matin est académique et gris. Autour de moi les petits bistrots de quartier sont tous fermés et je croise un silure de type perroquet, qui me regarde avec le même air blafard et patibulaire que moi. D’un commun accord, nous décidons de ne pas nous adresser la parole.
Plus loin, un sympathique Pachygrapsus marmoratus, surnommé Beni par ses pairs me tend un papier gorgé d’humidité, mais où l’on peut quand même lire : les mecs du chantier naval passent à 11:30 au garage.
Tartuffe et chocolat dans une palourde de mots et d’images. Je retourne sur mes pas pour me rendre pieds et poings liés à la planche de l’actuel « garage » fourré Tour du port. L’accès n’y est pas simple. J’ai les chaussettes si mouillées qu’on pourrait croire que le mouton qui me les a donnés l’autre soir, s’en est servi soit comme serpillère pour nettoyer ses eaux troubles soit comme linceul à mélanger avec du combustible pour visiter d’anciennes cryptes du sixième sous-sol des ruines de Santa Croce Matherone – mais – je me m’égare d’histoire et me trompe d’abreuvoir.
Ces grenouilles d’eau douce, orchidoclastes, et cul-de-jatte ventripotents de garagiste m’avaient pourtant assuré que ma pagode serait prête aujourd’hui, mais comme on dit il n’y a pas de fumée sans feu et même sous l’eau ! Prestement je quitte le sol et pars en brasse indienne pour aller plus vite. Je gagne du terrain sur les trois Ostrogoths qui font de l’ombre à ma hâte. Je dépasse le premier en lui assenant un coup de coude dans les marguerites et les autres me font place sans demander leur reste.
Ma flasque seiche.
Point perdu qui pensait croire, point prit celui qui croyait prendre. Le verbe haut, je suis tellement excité que j’en mélange même messe et écailles. Je bulle. La température qui m’englobe le corps prend facilement sept degrés. Vraiment il n’y a plus de saisons ! Trêve de pêche récréative, je passe la porte cochère avec une remarquable rotation sur nageoire avant de me télescoper par la force de ma brasse. Un thon sur les genoux d’un Sirin me félicite pour l’effort physique. Gentille cette poiscaille finalement.
Les phares montrent le chemin.
J’aperçois Roger avec mon vieux Trépas qui me regarde tous les deux avec un sourire aux lèvres tels deux hippocampes devenus pères dans l’heure. Mes larmes flottent à côté de mes mirettes, à la vue des phares qui s’éclairent d’ailleurs au même rythme que la troupe de saltimbanques d’à côté. Point de retard pour les carrioles chatoyantes. Je me suis fait eu. Étonné, méthodique dans la folie, mais heureux, j’appareille l’engin en poussant les gaz. C’est le moment de lever l’encre. Je démarre en trombe. Je croise sur la route les Ostrogoths de tout à l’heure et toute la faune sous-marine qui me fait des branchies et des sourires. J’enclenche le bouton de la capote, car il commence à pleuvoir. D’un air faussement calme, mais amusé, l’affaire capote parce que je me rends compte qu’elle est percée, mais qu’après tout ce bordel, ça fait du bien de respirer.
Crédit image : T.BURTON. 2004. movie Big Fish.