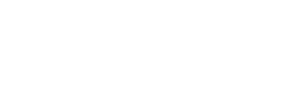C’était le matin et j’ai pris le bus. La ville était tout endormie. Les paysages ont défilé sur la vitre et j’étais à la plage.
Le cri des mouettes. Les mouches sur les algues séchées. Des restes de churros mouillés par la bruine de Normandie. La grande roue immobile. L’odeur des poissons frais du port. Les sirènes de départ du ferry pour l’Angleterre.
Je marche jusqu’à la mer qui s’est retirée. Le soleil se lève doucement comme pour ne pas brusquer le ciel. Le sable scintille sur les débris de coquillage. Le bleu de la mer envahit mes yeux, le bruit des vagues murmure le jour à mes oreilles, les embruns m’apportent les parfums de sel, l’écume vient caresser ma peau.
J’offre mon corps à la mer et la fraîcheur de la vague me
saisit. Je nage vers l’horizon et je regarde le bleu de l’eau, en sachant qu’à tout instant la lumière du soleil, devenue plus forte, peut en altérer la couleur. Je pense au ciel qui se reflète sur la mer, à ce soleil incertain qui joue avec les vagues, à l’écume lointaine qui rêve mes cheveux. Je pense aux figures absentes de ce paysage, je pense à un poème, à une image, à une chanson, à ma vie et je voudrais juste vivre.
Alors je remue les bras, je bois la tasse, je vide le ciel, je me plonge, je voudrais m’infuser le sel et qu’il me pousse des algues, que l’eau inonde mon émerveillement, noie mes pensées vagabondes. Défoncer les barrières qui subsistent entre le sensible et moi, pour épouser les éléments, et pour qu’enfin, enfin je cesse de réfléchir, pour que je cesse de me heurter à ces réalités interminables qui font naufrage dans ma tête texture ciel d’orage.
Le cri des mouettes, les algues séchées, la grande roue immobile, le sable tiède, le soleil chaud : je ne sais pas si j’ai, un jour, réussi à exister.