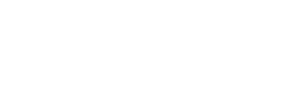Je m’étais finalement acclimaté à cette nouvelle occupation. Le bourdonnement de mon cabriolet s’étant apaisé au perron de l’imposante demeure de M. Ridinger, la quiétude emplissait l’air environnant, me rappelant que le doux chant que m’avait composé la ville fut trop loin pour que je l’entendisse. Je klaxonnai et refermai la portière maladroitement comme pour profiter d’un dernier arpège.
La première fois que je rencontrasse M. Ridinger, je fus saisi d’une grande peur, à la vue de cette immonde coque de chair : un visage bosselé au centre duquel trônait un nez cornu, rythmé par l’incessant ballet de ces petits yeux qui scrutaient mon arrivée. M. Ridinger était, quelques années plus tôt, un éminent journaliste et auteur d’ouvrages sociologiques, contempteur des temps modernes livrant une appréciation souvent peu flatteuse de notre société. Il s’exprimait souvent à coups de grognements et d’amphigouris, et lorsqu’il se mût pour me saluer, ce fut comme s’il eut été contraint de se déplacer continuellement avec une lourde armure telle que seul Dürer sût les graver ; il eut alors tendu vers moi une patte opulente et saisit ma main dans une poigne pétulante, en me lançant, plein de privautés :
« Au boulot, gamin ! »
Je me souviens encore ma première traversée de l’atrium, sombre, inquiétant ; l’univers qui me subjuguait, qui m’oppressait, est semblable à une forteresse de mensonge et de démagogie, un chemin plein de ronces sur lequel, pusillanime randonneur, je n’osais marcher. Les portes de la demeure eurent claqué derrière moi dans un bruit rond, assourdissant, faisant retentir une coriace âpreté pour le temps que durerait ma tâche : sur le cadran de l’horloge, je crus contraint de revivre chaque matin une forme de lassitude, une désespérance continuelle. Ma frayeur se fut intensifiée en entrant dans le bureau ; ce Ridinger, draconien, devenait âgé ; la sortie d’un nouveau roman calomnieux le préoccupait et il nécessitait dans sa bibliothèque de faire de la place, ce pourquoi il quémandât de l’aide pour son archivage. Sans le sou, mais plein de bonne volonté, j’avais tendu la main à ce vieil éclopé ; j’eus dû présumer qu’en prétendant que le travail serait “une broutille qu’on vir’ra fissa”, Ridinger l’aigrefin n’était qu’un affabulateur qui prenait plaisir à voir se décomposer ceux qui buvaient ses paroles face à la réalité mais qui, quoi qu’ils fassent, quoi qu’ils puissent faire, et quoi qu’ils feraient, ne pourraient faire machine arrière :
“La vérité est là : bosse, bosse, bosse et tu écraseras qui tu veux” m’avait-il annoncé alors.
Sans doute voulait-il dire qu’un travail de longue haleine me serait gratifiant.
Dorénavant j’ondoyais sereinement dans les couloirs de ce manoir ; je pénétrai la grande salle. Dès lors, un parfum de cédrat confit et de cacahuète agita mes sens, s’accompagnant en dernier ressort d’une fragrance argileuse dont j’eut du mal à m’accoutumer le premier mois de ma mission, et qui – aujourd’hui – m’inspirait une chaleureuse tranquillité. Sur une commode en palissandre, mon employeur avait jeté une farandole de paise de vingt-cinq qui témoignait de son périple en Inde, et me revint en mémoire la leçon qu’il m’enseigna alors qu’il me contât son voyage “La vérité est là : je sais pas où je crèche, mais le bonheur le sait !”. Je marquai systématique une pause après son sermon : d’abord car je ne parvenais pas à accepter ce langage de couard, mais surtout qu’il me fallut le temps de le traduire en moralité. Dans ce cas précis, j’y voyais une lueur, candide, de la recherche du bonheur : M. Ridinger avait beau multiplier les aventures, c’est le retour au foyer qu’il préférait. Sans doute – me disais-je – il devinait avant même de franchir le seuil de sa maison qu’en pistant le bonheur à mille lieues de là, c’est en fait le moment où il le quitta, comme le coffre qui cache ce cadeau est le carcan de cette condition.
M. Ridinger avait également le souvenir de ses périples dans le parc national de Tsavo East où, malgré un accueil mitigé, il se sentait paré d’une cotte imparable, tel qu’il s’eût sentit protégé : c’est pourquoi, comme une mise en abyme, les baies qui ouvraient sur la serre étaient corsetées, comme par des pilastres, d’affiches du Kenya : portes sur le monde, me parvenait un chant d’espérance à l’écoute de ces contes. Ce que me racontait le voyageur dorlotait mes peurs ; ses escales de par le monde avait un parfum de plénitude et à l’image des plantes dans sa serre, il m’expliquait ce que ses voyages lui ont appris pour favoriser un environnement où il plait à vivre “Y a tout un tas de belle chose à découvrir, j’t’en dit pas plus”. Par ces belles paroles il me promettait des agapes et non des ascètes, m’expliquait ce qui était juste et m’invitait à le croire. Je n’eus jamais le droit de vérifier par moi-même, mais je l’eus tant cru que ce matin, je me décidai à me promener dans le jardin. Ce ne sont les gonds rouillés qui m’ont arrêté : les portes de la serre m’admonestèrent de m’immiscer là où je n’aurais dû paraître, mais je persévérai et entrai dans la serre. L’air fût étouffant, m’emprisonnant de ses mains invisibles pour m’empêcher de respirer, et les plantes du verger en déliquescence me semblèrent moins vertes maintenant que je connaissais cette vérité sinople, et les fruits juteux que j’eût tant espéré voir, jamais ne les vis-je. Aussi suspecte fût cette découverte, je désarmais ma conscience de naïveté qui m’avait aveuglé de cet interlope histrion. Je refermai la serre et ouvrit la pièce suivante.
Le malingre attendait dans son bureau ; cette fois-ci, c’est l’odeur plus farouche et amère du papier humide qui enveloppait cette antichambre de corruption. M. Ridinger se tourna vers moi, s’apprêtant à me demander le nombre de parution de son nouvel opus :
“Combien ? questionna-il, suspicieux.
-Peu plus que la veille, répondis-je, tout aussi méfiant.
-Oh mince, lâcha-t-il presque à lui-même, on eut dit un enfant à sa façon de parler.
Il marqua une pause en replongeant dans le journal qu’il décryptait ; moi je m’étais déjà mis au travail, débutant l’archivage de sa bibliothèque, puis sans prévenir, à sa manière de contester le monde comme le reflet des mauvais résultats de ses ventes, il lança :
“Toute la vérité est là : les gens sont paumés et n’ont plus d’instinct ; moi je donne la bonne direction.
“Toute la vérité est là : si je te dis qu’un fruit est bon, tu le bouffes sans poser de question. “Toute la vérité est là : si tu penses par toi-même, tu te compliques la vie ; pense comme moi, ce sera plus simple.
N’en pouvant plus de ce sophisme totalitaire, je me tournai vers lui derechef pour l’interrompre :
“Toute la vérité est là : vous êtes un rhinocéros.
Il se figea un instant, une déclaration qui ne lui plût sans doute guère, qui le transformait
en statue, le temps qu’il faut pour digérer ces paroles ; or sait-il qu’il était seul ? Alors il se mût à nouveau, faisant trembler sa carcasse de ferrailles, et répondit simplement :
-Oui tu as raison”.
Jamais je n’eus su s’il avait compris ce que je venais de lui dire, peut-être même son esprit brouillé ne lui permettait pas de comprendre ce qu’il disait lui-même. Beaucoup crurent à son message, moi seul savais qu’il mentait, comme il avait toujours menti. Serais-je alors le seul à le décrier ?