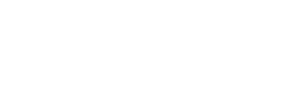Je ne voyais plus rien. Mais qu’y avait-il à voir ? Seul un voile ténébreux servirait ma
thérapie, et une discussion autobiographique, silencieuse, m’indiqua que j’étais seul. Mon
souffle ne s’estompait pas ; la course qui m’avait conduit dans ce dédale semblait tenir ma
conscience en éveil, comme pour assurer que, ce pourquoi j’étais là, je ne devais l’oublier. Il
n’y avait pour lumière que celle que je gardais dans mon souvenir, pour son que la légère
musique du cliquetis des pattes d’un insecte qui rampait sur le sable, et comme odeur une âpre
amertume, une humidité ambiante qui pourrissaient mes sens, et une délicieuse putréfaction, je
ne sais de quelle créature, peut-être un rat, ou un autre rongeur. Elle me rappelait également un
parfum que je ne connaissais que trop, mais elle alluma en moi l’intime conviction de mon
destin. Prenant conscience – enfin – d’une notion du temps qui m’avait échappé, je décidai à
me lever.
La cadence de ma respiration ne ralentît point : elle s’imbriquait parfaitement avec le
calme assourdissant qui colmatait l’espace, ce couloir de grès qui râpait mes doigts alors que je
passais mes mains sur les murs pour me guider : à ce moment, ma paume était devenue mes
yeux, et je n’avais pour seule alarme que le frétillement angoissé de mes pas sur le sol, qui criait
dans la silice ma solitude. J’allais droit devant, au sanctuaire de mes peurs ; j’avais l’habitude
de m’enfuir vers le soleil, l’espérance d’une doucereuse perspective qui s’offrait à moi,
échapper à ces griffes qui me tortureraient si elles se refermaient. Mais ici, dans les abysses
dans lesquelles je m’enfonçais, Râ m’avait abandonné, j’allais à tâtons, sans savoir où j’allais
et, peu à peu, je crus que mon refuge était en fait ma prison.
Soudain ma sirène fit retentir mes affres : là, entre mes pieds froids ondulait quelque
chose d’encore plus glacé, et à mesure qu’avançait le serpent le sol semblait me souffler, dans
un bruissement épatant, la noire sérénité dont m’honorait Apepi. Je n’ai pas peur des serpents,
pas plus que je n’ai peur du noir. La divinité ne cache pas son animosité envers la création
divine et les bontés de ce monde. Mais moi, je ne suis pas de ces houleuses charités qui ravivent
un philanthropisme exacerbé : altruisme, magnanimité et prodigalité sont des termes qui
m’échappent, aussi le serpent me laissera tranquille ; et quand bien même Apepi m’appellerait,
cela ne serait-il pas la preuve d’une pointe de générosité dans mes méfaits ? Alors, je reposerai
heureux. Le murmure du reptile s’éloigna, je poursuivi ma route, non sans un chagrin.
Lorsque ma main s’élança dans le vide, je cherchais une nouvelle paroi qui indiquerait
mon chemin ; dans le murmure de ma cécité, je discernais en vain le couloir qui mènerait à la
sortie ; bredouille, je me convaincs de rebrousser chemin : je n’avais aucune envie de finir
empaler sur un pieu de cèdre qui, sans doute, me mirait d’en contrebas. Alors que mes pas
reprirent une route décente, ma main, elle, ne reconnaissait pas la trajectoire empruntée plus
tôt, mais soit, c’est elle qui me guidait, aussi je me faisais à l’idée que cette fois-ci, j’étais égaré.
Ce n’est que quelques secondes plus tard – hélas, si lentes qu’elles paraissaient des minutes –
que mes pieds traînants chutèrent, et d’ailleurs moi avec. J’avais retrouvé cette fragrance putride
qui, comme un jalon, m’indiquait que j’étais sur la bonne voie. À l’aveugle, je reconnus une
bande de lin, cette substance fibreuse qui devenait plus irritante avec la gomme. Cela envahit
mon esprit autant d’un langoureux élan qu’une fatigue affolée : certes, j’étais revenu au point
de départ, mais mon intuition m’avait trompé, ce n’était pas un rat. Soucieux, j’avançais alors,
en suivant la direction que m’indiquait la momie, espérant m’approcher de la sortie, espérant
m’accrocher à la vie.
J
Un affolement grandissant agitait mes sens : je crois que je ne sais plus. Fallait-il
vraiment sortir de cette geôle ? Ne serait-il pas souhaitable d’attendre ici, qu’Apépi ne se ravise
et prévienne Osiris de m’emporter ? Chaque pas nouveau s’accompagnait de son lot de pensées,
et une nouvelle interrogation se profilait à chaque instant. Vais-je tout droit ? Faut-il que je
trouve à boire ? Dois-je prendre conscience de cet aveuglement qui engourdissait désormais
mes doigts contus, las de chercher la bonne direction ? Qui était cet homme qu’on eût
embaumé ? Avait-il un père ? Un foyer ? Un frère ? Une maisonnée ? Voyait-il courir dans la
cour de son gîte, un bambin excité à sa vue ? Avait-il un destin ? Une euphorie ? Un bagage ?
Une litanie des pleurs et des maux qui contrebalancerait la plume de Mât ? La momie, à mi-
mot, me susurrait-elle, élogieusement, qu’elle comptait me partager les secrets de la grande
question qu’elle seule, de nous deux, eut le privilège d’avoir la réponse, en me narguant de l’au-
delà ? C’est en constatant que le picotement qui griffait la plante de mon pied s’expliquait par
la perte de ma chausse en rencontrant la momie que je vis, au détour d’un énième couloir, le
jour qui me saluait et me conviait par l’encadrement de la porte du tombeau. Tous mes sens que
j’avais contribuer à forger durant cette épreuve pour remplacer ma vue furent vite mis de côté :
balayés les efforts, quand j’obtiens ce que je veux, je n’ai guère à m’interroger longtemps, et je
reprends mes viles habitudes. Je ne m’attache pas au passé, bien que le passé s’attache à moi.
Je respirais. Mes poumons se remplissait d’un air chaud, sableux, et je franchis l’embrasure
comme pour renaître de cette matrice de pierre, aussi acerbe que l’est mon cœur.
Le tableau qui s’offrait à mes yeux renaissants était d’une splendeur innommable : le
relief, d’un rouge orangée tel qu’il eut pu être coloré par le soleil couchant – patientant son
lever pour rétablir l’équilibre instable du monde – n’était ni abrupt, ni vallonné, façonné par un
dieu potier que je ne connaissais pas. Combien d’hommes et de femmes avaient traversé ces
chemins ? Le paysage était là, devant mes yeux, témoins de tant de nouvelles, de crimes
certainement, de marchandages. Des ouvriers sans doute avait péri sous un soleil suffocant pour
offrir à leur roi le tombeau qu’il se devait d’occuper. Le ciel était azur : il était l’océan de pureté
qui manquait dans ce désert aride, et ne cesserait dans les prochaines minutes à me rappeler
incessamment que l’eau manquait. Ma langue était sèche, râpeuse, et alors que j’entamais
l’ascension d’une colline, je crus suffoquer, tant ma gorge brûlait d’envie de se désaltérer. De
là-haut, je voyais l’entrée du tombeau duquel je sortis quelques instants plus tôt : une artère qui
pénétrait directement dans la roche, une prison de pierre qui m’avait préservé des regards de
mes traqueurs. M’évadant dans cet espace interminable, qui n’avait pour fin que l’horizon, je
n’avais à peine l’espérance d’entendre autant une insulte qu’un « bonjour » et une bourrasque
brûlante frappa mon visage, comme le coup de marteau du désert prononçant ma sentence : à
nouveau, j’étais prisonnier.
J’avais beau observer au loin, je ne voyais que ce schème répétitif de crevasses et de
frêle relief qui cadenassait ma destinée. La désillusion que chantait le vent ne me permit pas
d’entendre le bruit de mes pas, et les mirages au loin se jouaient de moi, aussi je ne saurai dire
si j’étais vivant ou non. Cette pensée me traversait l’esprit sans cesse mais elle trouvait toujours
une solution qui me raccrochait, malheureusement, à la vie : les piqûres qui déchiraient mon
gosier devenait si vives que je ne pouvais plus douter. Mon pied également, qui entre temps
s’était écorché sur une pierre saillante, me rappela à mon triste dessein. Je fus presque tenté, en
voyant un scorpion, de le laisser s’approcher. Pourtant je ne pouvais pas, je devais continuer, et
rejoindre l’oasis.
Les caravanes connaissent mieux que quiconque le désert ; aussi il me suffisait de
repérer un sillon de fumée dans le ciel pour me rapprocher d’une étendue d’eau. Cela causerait
ma perte, sans doute, de collaborer avec mes marchands, mais c’était ma seule issue. Alors
quand je vis dans le sable les traces profondes des pas des chameaux qui n’avait pas encore été
balayé par le vent, il me prit d’envie de chanter des louanges. Je plongeai ma main au fond de
ma besace, afin de m’assurer que mon sac de cumin avait, avec moi, fait le décompte de mes
péripéties et sans qui ce voyage ne servait à rien.
La faim commençait également à me tirailler, et la vue d’une maigre plante qui avait
miraculeusement survécu au désert semblait prête à m’être offerte pour le déjeuner. Je n’avais
de coin d’ombre pour profiter de ce court repas, alors je m’accroupis pour étendre ma main sur
les herbes. Je pris garde aux quelques épines qui ne me signalait qu’une épreuve pour mériter
cette collation, ou alors était-ce un message, une prévention ? Je n’avais que faire de ces
mauvaises mises en garde. La récolte sonnait comme de graves cordes usées de cithare qu’on
arrache pour les changer, les racines se désolidarisait du sol, non sans broncher, me grondant
de me préférer égoïstement ma survie à la sienne. Je découpais un pétale : la feuille était sèche,
empoisonnait mon palais d’une acidité enivrante qui emportait mon dégoût. Je m’autorisais à
me servir de cumin pour apaiser le goût et engloutir le reste. En me relevant, je me retournais
pour revoir, presque redécouvrir le tombeau qui, dans le silence de son mortier, m’autorisait à
le laisser.
Je ne saurai dire si le soleil frappait ma peau avec plus de force, si ma soif avait pris le
pas sur ma raison ou si les crampes que la mauvaise herbe assenait à mon estomac me torturaient
davantage, mais ce que je compris rapidement, c’est que la maîtrise de mon corps m’avait vite
contraint de me blottir dans le sable. Mes pieds avaient lâché, ils ne me supportaient plus, et je
crois que je ne pouvais plus les bouger. Je tentais de crier à l’aide, mais ma langue séchée ne
connaissait plus aucun mot. J’aurai bien revu la lumière encore, mais les courbatures de mon
ventre m’empêchaient de me retourner ; j’étais paralysé, le nez dans le sable, à la merci des
chacals, des vautours.
Une agréable sensation picotait ma nuque, rien ne me permit de penser que l’insecte du
désert s’en prenait à moi, mais j’avais tant espéré sa venue qu’il me fut difficile de rejeter sa
présence. Rapidement les chatouillements devinrent comme des couteaux qui roulaient sur ma
peau, puis sous ma peau, jusqu’à se répandre dans tout mon être, cette forteresse de solitude,
c’était ma prison de chair.