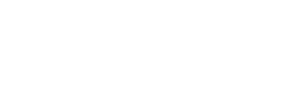La machine à café était d’humeur joyeuse ce matin. Pour chaque larme de moka qui tombait dans ma tasse modèle réduit (qui, soit dit en passant, est la seule bonne manière de boire un café ! – court à l’italienne), cette dernière chantait la Tosca. Ma tête vibrait en parfaite harmonie avec ladite machine. Il était clair que le duo cigare-armagnac de la veille avait laissé une trace quelque part. Mon Dieu, ce café allait être divin.
La sérénade achevée, je fixe la machine, une Smeg, rouge pompier, dans les yeux pour m’assurer qu’elle eût bien terminé son œuvre. Je n’avais pas envie de déclencher une commémoration en devenir, d’insultes trépidantes, de « goujat ! » à tout-va, comme le jour où j’osai interrompre la Belle Hélène.
Une fois mon éloignement du plan de travail, quelque peu décisif, heureux et satisfait, je me dirige vers le balcon, duquel le soleil prenait place. Gueule enfarinée tout de même. C’est alors que je l’aperçois : un hurluberlu.
— « Mais… qu’est-ce que vous faites ? »
— « J’arrose les plantes. Cela ne se voit-il pas ? »
— « Si, mais… vous êtes chez moi ! »
— « Donc j’arrose vos plantes. Cela vous déplaît-il ? »
— « Non, mais… vous êtes CHEZ MOI ! »
— « Eh bien, si on ne peut plus rendre service à autrui aujourd’hui… Où va le monde ? D’ailleurs, remarquons ensemble qu’il n’y a plus de saison, et que vos plantes avaient grand soif. »
Je me dis alors : Mon petit Paul, tu n’es pas réveillé ?
Je rentre à l’intérieur, m’asseoir à la table de la salle à manger, laissée pour compte après mon départ que je fis sauté comme un vrai petit rat de Paris. Je regarde alors l’intérieur de ma tasse à café pour m’assurer qu’elle contient bien un reste de café, et la repose séance tenante délicatement sur la table.
Je réfléchis, quelque chose cloche !
Au tintement léger que cette épiphanie produit sur moi, je remarque que nous sommes au troisième étage et qu’il n’est nullement possible qu’un hurluberlu notoire, en chaussettes qui plus est, se retrouve à mes côtés sur le balcon.
Je pense, je dispense, en fronçant les sourcils. Dans un fouillis de fanfreluches, des idées montent dans le train de mes pensées. Prier ensemble même lorsque c’est inutile,
« parce que c’est encore plus beau lorsque c’est inutile », disait le Cyrano de Rostand. C’est bien beau… mais cela ne m’avance pas à grand-chose. Depuis combien de temps ne suis-je pas allé me confesser ?
Le temps passe…
Il passe beaucoup aujourd’hui…
Pris de panique, je retourne sur le balcon.
Personne, je n’y vois alors strictement personne, et cela me rassure pleinement.
Cependant…
– Diantre ! La terre de mes plantes est bien humide !
Je n’ai donc pas rêvé !
Deux possibilités : soit je suis atteint de somnambulisme, auquel cas je n’ai plus qu’à retourner me coucher, soit j’ai un grave problème de souris d’appartement. Peut-être pourrais-je l’éduquer comme dans L’Écume des jours, et lui laisser des miettes de fromage, ainsi que quelques ouvertures propices où le soleil passe toujours afin de s’en baigner.
Quelques pas s’ensuivent en direction de l’intérieur de mon antre.
Je tire la chaise dont le vieux cannage du dossier grince, et je retourne, pensif, m’asseoir.
Mais non, ce n’est pas ça.
Il y a donc quelqu’un chez moi !
Je me lève alors en renversant ma chaise ; le coussin en molleton qui était sur l’assise tombe également, en faisant d’un détour un demi-tour en l’air. Je marche sur ce dernier et m’évite de justesse une chute malheureuse en m’accrochant à la table en chêne, celle-là même qui m’a déjà soutenu dans des circonstances plus… galantes.
Mes pantoufles, confortables et silencieuses, dont les visages d’Yves Montand et de De Funès trônent fièrement, me permettront de faire un déplacement latéral dans mon appartement de 82 m², afin d’en explorer chaque recoin.
Je quitte la salle à manger en me télescopant jusqu’à la chambre, dont la porte blanche est toujours entrebâillée.
– Êtes-vous là, arroseur de plantes ?
– Mesquin ?
– Coquin ?
– Pimprenelle ?
Silence.
Silence.
Silence.
Rien.
Aucun bruit ne se fait entendre. Je retourne alors Flocky flocan m’asseoir. J’y ai, auparavant, redisposé le petit coussin moelleux pour mon postérieur méritant. Au loin, la machine à café verse de nouveau une petite larme de moka en do dièse mineur.
À cet instant précis, mon regard tombe sur la porte de la salle de bain, qui était jusqu’à présent fermée.
La particularité de cette dernière est un contour en bois de jeune chêne, auquel un vitrail est posé en son cœur. Il y a des roses et une mésange habillée de bleu et jaune. Elle vole et tient dans sa griffe droite une rose qu’elle dépose. Où ? Qui suis-je pour savoir cela. Cependant, mon logeur étant un personnage antipathique et proche d’Harpagon, le bas de cette grande porte, dont le vitrail fait toute la longueur, est manquant. De quoi reconnaître toutes les activités des personnes présentes dans la salle de bain…
Ainsi, mes yeux se posent sensiblement sur une magnifique paire de chaussettes marron clair, sur lesquelles sont disposés de somptueux diplodocus dont on distingue bien le long cou, le visage gentil et le regard hagard.
Pompon, petit pas, tapon. C’est ce que la vision coupée du bas de la porte vitrée laissait transparaître aux curieux : des chaussettes paléontologiques. Quand un adulte quitte l’enfance, parfois, l’un d’entre eux garde sa simplicité et sa tendresse qu’il cache au creux de ses souliers. L’apercevoir, c’est un clin d’œil merveilleux, pour celui ou celle seulement qui sait la recevoir à la lueur d’une lanterne rouge.
Et là…
Je vis !
L’une et l’autre, elles se tenaient là devant moi.
Sacrebleu! Il y a quelqu’un chez moi !
Ce n’est pas possible, et en plissant les yeux, je relate à mon histoire qu’avec cette mimique, les pieds droits comme la justice au milieu de la salle de bain, l’on dirait que la personne se sèche les cheveux avec mon linge de bain !
Je virevolte. Je me lève promptement et fais choir une nouvelle fois la chaise sur le sol. Cette fois-ci, le petit coussin molletonné est resté attaché à la chaise. Je me télescope jusqu’à la porte vitrée de la salle de bain, je l’ouvre présentement.
– Ah ah, qui êtes-vous là ?
À ma toute grande stupeur, il n’y a personne.
Suspicieux, craintif et affable, je me repose quelques instants sur l’émail de la baignoire blanche. Mon vieux, tu deviens fou, ce n’est pas possible autrement.
Ma main saisit le bord de ladite baignoire, qui est, selon une constatation récente : gaugée ! J’inspecte de plus près la baignoire. Je me rends compte qu’elle est mouillée et qu’un malotru y a laissé une touffe de poils. Je me rends également compte que mon linge de bain blanc, brodé de petites fleurs champêtres bleues, est en train de sécher et est entièrement gorgé d’humidité. Il y a, par ailleurs, encore de légères traces de vapeur sur le miroir, et la fenêtre qui siège au-dessus de la baignoire est entrouverte.
Paul, mon petit Paul, il va donc falloir que tu arrêtes de manger le cachou de Geneviève.
Je quitte la salle de bain en pas chassé.
Croiser, plier, croiser, plier, croiser, révérence. Je relève ma chaise et je m’y assois.
Je prends ma tête avec les deux mains en cachant mes oreilles, pour ne pas que les esprits tortueux ne hantent mes pensées.
Ce n’est pas possible.
Nous sommes au troisième étage d’un immeuble qui en fait au moins huit. Je possède un menu balcon qui n’excède pas quelques mètres carrés, sur lequel reposent ma bande de rosiers ainsi que quelques plants de tomates trop souvent oubliés. La fenêtre de la salle de bain plonge à vide sur la rue Colbert, il n’y a pas de chéneaux, ma porte est fermée. Geneviève ne vient que les samedis. Or, nous sommes vendredi et je ne suis pas fou, car le fou ne peut ni aimer ni travailler. Alors que moi, je ne peux ni travailler ni aimer.
Pensif, je me perds dans mes idées.
Est-ce que Geneviève ne serait pas venue vendredi au lieu du samedi ? Je m’y perds. Et d’ailleurs, quel jour sommes-nous ? Et finalement, qui est Geneviève ?
Une légère brise me chatouille le museau, je relève la tête et constate la porte du balcon entrebâillée. Un ouvrage d’ouverture balconière tout classique, avec deux petites broderies sur chaque vitre, afin que, tout de même, lorsque le peignoir tombe, le voisinage ne puisse contempler mon plus simple habit d’apparat.
Est-ce bien moi qui ai laissé ouvert ?
Je ne sais pas, je ne sais plus.
Quelque chose cloche.
Cling
Cling
Cling.
Je me lève et me télescope de nouveau sur le balcon. Ce que je sais, c’est que lorsque le chat a la queue verticale, il est en confiance, mais cela ne m’avance pas à grand-chose non plus.
Je prends dans ma main une feuille de l’un de mes rosiers, et je dis :
– « Ernest, vous me le feriez savoir, si quelqu’un d’autre que moi venait vous officier comme abreuvoir ? »
Sans réponse d’Ernest. Je tourne. Je tourne alors sur moi-même, ma robe de chambre tournoie en cœur et me fait ressembler à un bouton d’or qui va éclore.
En bas de la rue, de laquelle donne le balcon, la petite rue Mercier est souvent calme, sauf le samedi, car elle rejoint la place du marché, qui déborde toujours sur la petite rue. Cela s’explique aisément, car les artisans, bouquinistes, fleuristes et saltimbanques locaux sont plus nombreux à chaque fois.
De là où elle est, c’est-à-dire à sa place, Madame Anne, qui vient comme à l’accoutumée faire son marché le samedi avec son petit cabas qu’elle tient fermement dans sa main, est attirée alors par une plainte jouissive. Levant les yeux pour voir de quoi il s’agit, elle remarque alors un homme, en robe de chambre jaune, tournoyer sur lui-même en se posant des questions, comme un bouton d’or qui va éclore, tout en parlant à ses rosiers.
Elle s’exclame alors :
– « Bien heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ! Le fou du troisième ne cessera donc jamais d’éclairer nos lourdes matinées. Quelles histoires se raconte-t-il ? De là où je suis, c’est-à-dire à ma place, j’y discerne un lanternon rouge, et je suis sûre qu’il porte encore ses chaussettes paléontologiques. »