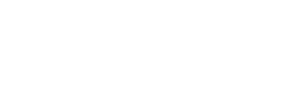Du plus loin que je me souvienne, j’ai en mémoire la vue que m’offraient les champs de colza en fleurs, comme si la vallée devenait sous mes yeux d’enfant une mer jaune qui engloutissait les arbres et les maisons, sombrant dans cet océan oléifère. Plus que le souvenir, la sensation. Le printemps imprimait sur ma peau à l’orée du râle chaud du crépuscule l’embrun doux de la rosée et la fragrance torréfiée de son pistil sourd en courant dans le champs, et la valse des nuages pour ciel de lit lorsqu’innocemment je m’y allongeais et m’assoupis. J’ai depuis lors une amitié particulière avec les fleurs, qui accompagne ma jeunesse pour que j’éclose, et aille développer mon caractère comme on ajuste ses pétales. Depuis cette nuit mystique à contempler les étoiles où les brins de colza s’élevaient autour de moi, chaque nuit m’est une nouvelle gestation où ma naissance au réveil accouchait de pensées nouvelles, comme une rêverie que je poursuivais éveillé, la nuit m’ayant susurrée quelques réponses aux mystères de la vie ; et chaque soir était une nouvelle mort qui se profilait, comme une répétition officieuse pour le jour de mon deuil où la complicité que j’eusse entretenue ces années durant avec les fleurs se verrait célébrer en inondant ma tombe. Aussi ce trépas renouvelé ne me guidait-il pas vers ce jour inconnu dans une certaine indifférence, mais dans une suspicion camouflée, puisque contrairement au jour de ma naissance, que je croisais chaque année à l’occasion de mon anniversaire, le jour de ma mort figurait pourtant parmi les 366 possibilités que j’avais déjà rencontrées, et devenait d’une accablante frayeur de le méconnaître, mais d’une excitation rationnelle de l’avoir rencontré sans y prêter attention.
Les germes de l’innocence ayant ensemencé l’ire de ma curiosité, j’accompagnais régulièrement madame de Barington dans les jardins de ma bienfaitrice, la princesse d’Estongarelle, à la fin de l’hiver avant que les colzas ne bourgeonnassent. Me recueillant dans une pension d’été où je passais les vacances d’avril à août, madame de Barington m’avait inculqué les rudiments essentiels du botaniste amateur, non seulement le nom des fleurs, et comment les entretenir, mais également comment s’en émerveiller. Alors que j’assemblais les branches déchues des charmilles en fagots, une odeur douce et sucrée vint chatouiller mes sens, et ma joie s’en fut sentit si déployée que j’avais alors à émettre le souhait de m’installer auprès de ce buisson et de vivre en ermite, me délecter de cet air qui créait en moi une accoutumance paradoxale, comme pour faire de ce parfum mon tombeau, et d’un embaumement m’y préparer. Et plus je décortiquais ce sentiment je le rapportais à un souvenir de promenade au bord du canal où, sans parvenir à me souvenir si le parfum était le même, il m’invitait à la même dépendance ; on m’avait enseigné alors qu’il s’agissait du chèvrefeuille, et qu’il paraît à merveille la mélopée puante de la vase du canal. Je m’enquis alors de manifester cette joie immense que me procurait le chèvrefeuille à madame de Barington, propos duquel elle me gronda, arguant que ce n’était pas du chèvrefeuille mais du seringat, et que, puisque je n’avais pu distinguer les deux, j’avais pour punition d’ôter le lierre envahissant du puit. Je crois savoir que depuis ce jour madame de Barington professait d’un discours tout à la fois abscons et suspicieux lorsqu’elle me partageait sa science des fleurs.
Nous étions au Père Lachaise, le jour où nous enterrions la princesse d’Estongarelle ; de mon chagrin qui s’était étiolé, un bouquet de pétunias dans les mains, j’avais pourtant ressenti un agréable soulagement, comme si ce sommeil qui m’avait épris plus jeune dans le champs de colza n’avait d’éternel que le temps de le restituer à la princesse, un temps qui fut une parenthèse dans la vie où elle s’assurerait en me mettant sur le chemin de madame de Barington que je me coltinerais à connaître et cultiver les fleurs de son jardin sur celui de sa mort. Le courroux de la botaniste se fut sans doute fait entendre en voyant que mes mains se furent déliées du serment des chrysanthèmes, elle s’adoucit toutefois en remarquant que la couronne que j’avais tressée de roses Samaritan et, quoiqu’elles provinssent d’un arbuste des plus rares du jardin elles fussent néanmoins les préférées de la princesse. La cérémonie d’obsèques se poursuivant, avec Mr. Wallis notre cocher – qui grattait le gravier des allées du bout de ses bottes – et Mona la gouvernante, j’aperçus se baladant à l’affût des tombes une jeune fille avec un bouquet de colza. Mais la couronne de Samaritan fut si odorante – non pas que, comme le crût madame de Barington, je les avais cueillies parmi les plus aromatiques du jardin, mais fraîchement récoltées dans le parterre jouxtant le cimetière – que j’associais son apparition à ce parfum enivrant, et par extension au bouquet de colza. Et dans ma mémoire, le parfum du colza n’était plus attaché au souvenir de cette pâque étrange qui avait ravit la vie à ma jeunesse dans le champs, puisque l’image que j’avais associée au colza n’était elle-même plus rattaché à son parfum, mais à l’irruption intempestive de cette silhouette jaune qui parasitait mes adieux à la princesse.
L’inhumation n’étant plus dans nos mémoires qu’une amère acceptation dès lors que la bière avait disparue de la surface douloureuse de nos pupilles, et que nous dodelinions tête baissée dans les allées du cimetière ; j’eus pour souhait de promener ma débâcle jusqu’aux sépultures de la mouvance delacrucienne, car je savais y trouver une sculpture d’un artiste dont la célébrité n’avait su recueillir son accolade, un certain Caudurier que j’appréciai mais que la plupart de mes condisciples raillait. J’observai d’un coup de tête combien les tombes étaient moins fleuries, délaissées, oubliées dès lors que s’éloignait la Toussaint, et que le couperet tombant nous affligera probablement de la même sanction à notre fin ; sans fleurs, la promenade dans les sentiers du Père Lachaise était morne et inodore, et qu’à l’extrême opposé du calendrier le rival du premier novembre – le premier mai donc – malgré le printemps de sa robe débourrant, était du cimetière le plus sinistre des jours. Quand j’arriva devant la statue, je compris inévitablement pourquoi elle fut tant décriée ; ce n’est pas tant parce qu’elle reprenait, copie conforme, la posture monumentale de la Piéta de Michel-Ange, et ainsi le défunt reprenait la place du Christ dans une fusion inabordable et pour le moins anticléricale, mais parce que son sous-titre Mater Dolorosa ne laissait entrevoir, au travers du voile qui recouvrait sa chevelure et le mystère de son visage, aucune larme et le nimbe d’un sourire. Moi au contraire j’admirais la technique de l’artiste, la façon dont il rendit la transparence du voile en dépit de la force de la pierre, la légèreté de la mantille en dépit de sa lourdeur, le détail de la broderie malgré sa discrétion. La sculpture était la Toussaint de l’artiste qui avait dès lors vu sa postérité défleurir, et tous les artistes avec lui subissent la même exaction. Pourtant au pied de la tombe, avait été déposée une branche de colza.
J’avais gardé ce souvenir dans un coin de ma tête, alors que l’été durant je poursuivais mes leçons d’horticulture auprès de madame de Barington, et si le pupile que j’étais pour elle était auparavant le fruit d’une assiduité forcée, elle était depuis la disparition de la princesse une chaleur nouvelle que je conquis loin du manoir vide et froid d’Estongarelle. Le soleil, chaud et généreux, vint apaiser les affres et le lait de ma peau d’hiver qui, à son contact, refleurit. Son souffle tiède et soyeux m’appelait à la clameur de l’orangerie pour m’éloigner des lignes glaciales de mes lectures. Madame de Barington m’apprit alors le fastidieux usage de la patience, lorsque fébrile on m’inculquait la taille du citronnier, à le débarrasser de ces appendices suffocant ; et plus les tiges fondaient sous mon sécateur et du timbre exotique de ses bourgeons, plus le poids de mon chagrin pour la princesse semblait rendre un leste que je su porter. Nous pûmes cueillir les citrons dès la fin du mois d’août et servir ma première limonade la veille de mon départ, prêt à embrasser la fraîcheur de la boisson comme j’aimais à croquer la vie, à m’en désaltérer, comme le serin dans un champs de pétales jaunes fermait mes paupières sur cet été suave, une parenthèse altière nous emportant dans des horizons suffisamment méconnus pour que, à trop les fréquenter qu’il nous fût interdit d’en jouir davantage, nous admirassions ce chant commun en rouvrant les yeux pour la première fois, mes devoirs m’imposant de nouer une nouvelle conquête avec le collège.
L’absence de madame de Barington n’avait pas altéré la science de son éducation qu’elle eut auprès de moi. Si je peux dire avoir appris à ses côtés plus que dans les manuels de biologie – que les hussards en blouse grise martelaient à coup de règle sur ma tête comme on enterrerait dans la terre un rang de piquets pour les noirs de Crimée, et ce afin de fertiliser mon esprit – j’engloutis davantage en ce cours épistolaire ; et lettre après lettre, mes petites cellules grises fleurirent et, rosier grimpant, se parèrent de pimpantes et pétulantes aquarelles colorées à la croissance et la crédence de ma raison. De la rondeur des lettres élégantes j’entendais la voix de ma tutrice flatter que ma curiosité était l’étamine des pétales dont la palette va du pêche à l’indigo, c’est-à-dire, sur le spectre des couleurs, pas aux extrémités… mais presque ! La peine me serrait le cœur lorsque Madame de Barington poursuivit le récit d’une toux qui éreintait sa trachée, récit dont je n’avais pas eu la genèse. Je ne su qu’au courrier suivant qu’après le dernier paragraphe où j’avais trouvé la fin bien abrupte il y avait un grand vide, mais que ma lectrice avait abandonné son encre bleue pour l’essence invisible du jus de citron. Mon instinct me dicta alors pourquoi de toutes les fleurs du parc d’Estongarelle celle du citronnier fut pour elle sa préférée ; c’est qu’elle laisse dans son sillage le présage d’un vide plein. La Toussaint approchant, la toux de madame de Barington se fit de moins en moins passagère, j’entrepris alors de mettre un terme à notre correspondance, car naïvement j’accusais cet échange d’information d’être la cause de la maladie qui empoisonnait le souffle de ma tutrice, et je me persuadais que si elle persistait à me donner de ses nouvelles de son mal état elle ne pouvait que guérir puisque j’avais ôté de moi toute possibilité de le connaître, et qu’ainsi s’en fut de mon fait et que ce fut moi qui l’ai guérit. Je pensais encore qu’elle se lamenterait de mon mutisme, mais là encore je n’avais à en souffrir puisque je méconnaissais son malheur et qu’alors je concevais son bonheur. J’appris que l’imagination d’un enfant n’a d’égal pour consolider le bonheur, j’appris également que les amitiés sont comme les fleurs, et qu’elles flétrissent si l’on n’arrose, et que les amitiés sont un engrais pour le cœur.
Il fallut épousseter la neige pour décrypter son épitaphe, et du creux de la main ôter la poudreuse qui enveloppait sa tombe pour découvrir ce trésor caché. J’avais étendu le bras, tel un roseau pour éclairer les cierges, et de sa chaleur dévoiler cette griffe invisible. Comme l’un de ces limons exquis que j’avais pris la patience et les coups de baguettes d’apprendre, madame de Barington était une de ces pommes d’or à l’écorce bien rude, à la saveur agreste, à l’agression bienveillante qu’elle enivre de l’amertume de sa voix, et des pépins désagréables qui se mêlent à ce charnier infernal ; elle était sans doute également un être à l’âme atrophiée qui mérite que l’on s’arrête au sucre de sa rencontre, aussi fraîche qu’une limonade en plein été, une sainteté peinte à l’encre invisible que l’on se devait de révéler : et désormais je me rendais compte de cette vertu, et elle était alors ma plus belle rencontre de ce cimetière. Pourtant l’on m’avait témoigner qu’à son trépas elle tenait farouchement en sa poigne un brin de colza. Je repensais alors à cette fille au bouquet de colza que j’avais entraperçu aux obsèques de la princesse d’Estongarelle, visualisais sa jupe jaune et son chemisier blanc, et le bénéfice de ma mémoire vint au bénéfice de sa candeur – et je ne sus dire si c’était par pensée qu’elle me fut apparut ou si son apparition avait chuchoté à mon subconscient de penser à elle – si bien que mes pensées la rejoignant elles s’éloignaient d’autant de Mme de Barington qui n’avait semble-t-il qu’à récolter son brin de colza pour échapper à mon attention. La silhouette de la fille en jaune se découpait dans le blanc velours de l’hiver qui drapait la parade funèbre d’un oubli évasif. Je n’avais qu’une parole à lui avouer, une question à lui poser, des intrigues à soulever et des rêves à témoigner, et toutes ces propositions trouvaient leur origine dans le refuge de Madame de Barington et la tombe de Caudurier qu’elles avaient dans le colza. Finalement, c’est à trop s’empresser que le bouquet de colza s’éloigna, ne laissant dans la neige aucune trace à remonter pour poser mes questions. Très vite, le froid et les jours de l’hiver m’abandonnèrent à une errance nocturne où le sommeil m’avait lâché dans ses draps.
Mon attention s’éveillait un peu, à l’amble d’un malaise et d’une dyspnée grattante. Comme pour signifier que ce ciel de lit qui n’offrait plus de voie aux étoiles, mon regard refusait de se laisser aller à sa besogne quotidienne. La ritournelle cadencée que murmurait Mona était le seul balancier de mon agonie. Elle assurait délicatement d’une serviette que mon front fiévreux et nimbé ne me noie de la sueur qui expulsait la peste de mes entrailles, et là, lové dans les édredons je suintais de ce désir exquis qui rêvassait dans ce tombeau hypnique le lit de ma ruine. Brûlant et frigorifié, trempé mais la bouche sèche, je baladais ma vertu à l’horizon d’un océan de conscience, dérivant sur la chaloupe de la déliquescence, je me noyais dans un oxymore, comme courant à nouveau dans un champ de colza, à recueillir les perles de pluie sur les pétales à la tiédeur de la vêprée. L’éponge aspirait comme il découvrait chaque aspérité de mon visage, et ce reflux en fleur effleurait l’affolante rafle comme une nef sur le fleuve afflue vers la fine fin, fleuve sur lequel je voguais à l’onde d’un vertige me guidant, puisque en m’épongeant, on aspirait mon eau, mon âme, mon essence. Je parvins finalement à ouvrir les yeux ; dans ma chambre elle venait me visiter, la jeune fille au bouquet de colza, sans considération pour Mona qui soudain s’était mise à pleurer. Mon amie du cimetière, à l’allure angélique, s’approcha, gracieuse sibylline, dans des pas de soie rose et lila, et élança à lippes tues la cage de ses bras sur mes épaules frêles ; en les passant autour de mon cou, les pétales de colza chatouillèrent mes oreilles que la mélodie de Mona n’amenuisait, le refrain résonnant comme le dernier son que j’eus pu entendre, et dans les bras de la fille au bouquet de colza au soleil accueillir ce présage. Mais de cette étreinte, c’est le musc du colza non seulement qui m’embaumait, mais l’acide aigreur du citron, et le seringuat, la Samaritan, le pétunia, le chèvrefeuille qui déposèrent sur moi la délicieuse fragrance de la guérison.