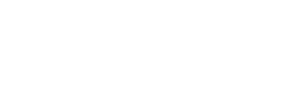605-622
Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas qu’il n’existe pas. On avait beau m’asséner de ce proverbe cardinalice, pour moi si l’on ne voit rien, c’est qu’il n’y a rien. Déjà Saint-Exupéry voyait le désert plus beau s’il y avait un puits, non pas qu’il le voie mais qu’il sache sa présence inexorable. Et Caravage n’avait-il pas révélé l’extase de saint François dans un pur clair-obscur, par une timide étincelle, discrète, au creux de l’iris – soit disant passant, tous ses contemporains figuraient l’extase dans une éblouissante lumière, tant et si bien qu’on ne voyait plus l’extase ! C’est peut-être ce que l’on essaie sans cesse de m’inculquer : à force de montrer, on ne sait plus voir.
Un jour – et c’était une soirée tout ce qu’il y a de plus convenable – on trouva un piment dans une bouteille. Déjà l’un des convives étala sa science, après avoir vidé le contenu d’une autre bouteille (de rouge celle-ci – nous pourrions surexploiter son alcoolémie mais on risquerait de s’égarer), il déclama d’une voix suave et grave, en levant son nez rouge (entendons bien que ce n’était pas un clown, même si c’était drôle à voir) : « ce n’est pas le piment qui est rouge, mais la longueur d’onde qu’il renvoie. Si on l’éclairait d’une lumière verte, nous le verrions noir, car toute autre lumière d’une longueur d’onde différente serait absorbée. Et que verrions-nous s’il n’était pas éclairé ?
– Rien ! lâcha-je d’un ton quelque peu présomptueux
– Effectivement. Pourtant, cela signifie-t-il pour autant que le piment n’est pas là ? »
Je pris la remarque à la légère, même si j’en compris la philosophie. Et la leçon fut comprise en dégustant ladite bouteille à l’aveugle : il y avait bien du piment dans cette bouteille.
622-740
Je passe encore un instant devant cette toile, un monochrome morne. L’artiste avait sans doute vu le Bleu YKB, le carré blanc sur fond blanc de Malevitch et dut se croire tant remplit d’originalité en proposant un aplat de rouge sur la toile. Mon ami vient. Pas de réaction, pas même un rictus, un air de dégoût. Que sais-je encore ? Il me demande : « Que vois-tu ?
– Du rouge ! » Répondis-je négligemment.
Quel était le sens de cette question ? Pouvais-je nuancer ? Était-ce du carmin, du coquelicot, du purpurin, du vermillon, du corallin. Ferais-je la différence avec un rouge-orangé, un pourpre ou un vermeil ? Y verrais-je des reflets rubis, des boucles d’escarboucles, des lignes mordorées ? Comme je riais jaune mais que je voyais sa mine sombre, je lui demandais.
« Et toi ? Que vois-tu ?
– Du vert ». Me répondit-t-il aussi négligemment que je l’eut été alors.
Alors quoi ? Se payait-il ma tête ? J’entrais dans une telle colère noire qu’on allait me confondre avec le tableau.
« Non seulement je vois du vert, mais je vois surtout la violence de l’empâtement qui a conduit la main de l’artiste. Je vois la richesse des sillons que le pinceaux creusât ; je vois la lumière qui anime la toile aux passages des visiteurs. Je vois l’émotion du peintre, la déchirante rupture de sa vie et la rage des affres de son époque qui l’affectent ».
Pas bête ce daltonien.
-494-499
Paroles infrarouges par le discours ombragées
Forgent l’iceberg de la pensée.
Cette vérité que corsète une perception :
La réalité sans passion.
L’auditeur ne commet d’autre outrage
De n’entendre que ce qu’il souhaite
Il en saura bien davantage
Que ce que ma pensée reflète.
Mes paroles infrarouges, je n’oserai te les dire,
L’errance du langage a ses limites.