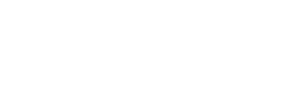Réveil froid. Agueusie de l’être, captant une existence sans goût : telles furent mes premières émotions. L’impression qu’une oppressante claustration compressait mes sensations qu’un vide trop opaque retenait. En somme une anhédonie complétait l’hypoesthésie que m’eut dû diagnostiqué le médecin. Sifflement. Clapotis. La cage se décompressait ; un gargouillement malveillant semblait signaler que la machine se remettait en marche. Grincement des vérins. Affolement électronique intermittent. Le capot se relève ; Voilà, Vie, que tu m’acquisses par usucapion.
La lumière orangeâtre s’engouffre par-delà mes paupières. Cette lueur d’espérance me guide, mais je reste allongée. Mes jambes, encore paralysées… Les fluides médicamenteux qui conservaient mes fibres musculaires se dissipent, et l’eau dans laquelle je baignais s’évacue. J’entend leur borborygme. Douloureuse ankylose qui s’invita. La confiance me supporte, mais mes yeux refusent toujours de souffrir : je suis comme un visiteur aveugle qui se déplace dans une ère impalpable. Soudain je vois clair ; ma respiration est saccadée et mon pouls s’affole. M’enfin. Je vois. Lentement une jambe s’apprête à se poser au sol. Est-ce là le pied-à-terre d’un vagabond ? Le funeste rêve qui titube d’un funambule funèbre dont le corps le rappelle à sa pesanteur implacable ? Premier pas dans ce nouveau monde : il m’est autant étranger que cette impression inédite… ou plutôt ce rien qui m’emplit. Deuxième pied posé. Stabilité assurée. Mon scaphandre me sert de chaise.
Le monde nouveau est froid mais coloré, inquiétant mais inchangé.
Le nouveau monde est sain mais boiteux, simple mais orgueilleux.
Je m’approche de la fenêtre et jette un œil sur le boulevard, non sans un zigzag m’obligeant à m’agripper aux parois pour y accéder. Et ce fut d’un étonnement total : on se sut crût perdu dans les ouvrages darwinesques théoriques qui m’ont exproprié et poussé au voyage, nomadisé ; le temps que j’avais sucré au temps, il avait tenté de m’en ôter autant, plongé au cœur des romans de Balzac, de Maupassant, d’Hugo, de Zola, de Gautier, de Mirbeau ou Mérimée, côtoyant l’imaginaire d’un Lucas ou d’un Besson, et dont la pâleur était signé Orwell. Sur le pavé battaient les sabots des chevaux ; la rue circulait sous mes yeux, animée de calèches, de landaus, de cabriolets. Les passants ici-bas étaient vêtus à la mode des impressionnistes, alors que de larges écrans avaient remplacé les kiosques, et dont la lumière orangée dont j’ignorais la source tout à l’heure accaparait l’air. C’était la grandeur, le faste et la majesté d’un hausmannisme exubérant qui côtoyaient la vivacité du numérique. Êtres du futur, vous vivriez donc dans un chiasme.
Grognements non loin. Mon attention se détourne de la route ; là dans un coin, affalée au sol. Ce n’est pas la virtuosité de son chignon blond qui m’étonnait, ni la volupté des plis de sa robe empesée, mais du cryptogramme phosphorescent qui luisait sous le derme de sa main, et de cette voix rauque qui me crachait « Foutue malédiction, d’où tu sors toi ? »
Analepse nécessaire.
Année 2021, Cité des sciences, Paris
Depuis plusieurs années, un éminent hypnopraticien spécialisé dans le sommeil travaillait sur une nouvelle technologie de cryogénisation ; l’année précédente avait bousculé son calendrier, convaincu de l’opportunité de ses recherches pour résoudre la situation. J’étais, a priori, la candidate idéale pour un premier test.
« Imaginez que si nous plongions un panel d’individus durant une durée d’incubation et d’exposition à des traitements adéquats, les sujets à cette nouvelle méthode de cryogénie médicale pourrait développer des anticorps sans agressions extérieurs. Le corps s’endort mais continue de travailler. Alors à leur réveil ils seraient bien plus résistants, plus robustes. C’est aujourd’hui le départ de cette expérimentation ».
Le cobaye – moi – s’était allongé dans une sorte de scaphandre qui reposait sur un socle, lui- même, par de savants calculs de maîtrise de gravité électromagnétique, lévitait à quelques centimètres au-dessus du sol. Au centre des regards émerveillés de la salle, j’acquiesçait contre mon gré la manigance péremptoire qui s’opérait devant les yeux ébahis des spectateurs ; car oui ce fut un spectacle, et ce n’est pas l’envie, ni la fortune et la gloire qu’ils promissent à mon réveil qui m’eurent motivés. Car face à ce choix cornélien qui s’impose, entre la menace d’un licenciement immédiat et la participation à une périlleuse expérience, il n’y a d’acception rédhibitoire : c’était soit la famine et la rue maintenant, soit la famine et la rue dans trente ans. Lumières et ovations. Malgré tout, c’est cette phrase qui continuait de résonner dans ma tête comme un pollice verso « Rendez-vous en 2051 ».
Retour à la réalité
Retour à l’incompréhension
Ma présence dans la pièce n’est pas la bienvenue. J’agis comme un corps étranger qui jubile, alors que gît dans le génie de l’ingénue la croyance plagiée, simulée, de n’incarner la cause de cette rage passagère. La jeune fille, cachée derrière un billot, se prénommait Daphné ; d’une vingtaine d’années, elle avait dû naître et grandir dans les années 30. Décennies de malheurs qu’elle me contât après qu’elle m’eût cru. 2031 : 4 milliards d’êtres humains peuplent la Terre. Hausse de la pauvreté. Les agriculteurs et les secteurs agronomes, les médecins, infirmiers, chirurgiens disparaissent les premiers « les cerveaux de la guérison » dit-on. Famine. Faiblesses immunitaires. Certains se disent oracles et prédisent la naissance d’un enfant qui, en grandissant, sera à même de rendre au monde la vie savoureuse d’antan ; un enfant venue au monde des
peuples de l’eau. Alors que la montée des eaux s’accroît, une femme dont le village était en proie à des inondations depuis vingt ans est sauvée par un militaire de la Marine Nationale. De cette rencontre naîtra Daphné, dont le monde voit en elle l’enfant prophétique attendu.
« Ma naissance, dit-elle, est aussi ma malédiction. Si les prophéties s’avèrent, je l’ignore ; mais à trop attendre, on a tendance à voir ce qu’on a envie de voir. Le fait est que des plus indécis j’étais une cible, jusqu’à voir mes proches dévorés par les flammes, alors que le nourrisson que je fus y échappa. « Intervention divine ! » lançait quelques illuminés. De ce brasier naquit une légende qui attisait les folies, et on vit paraître la jalousie des gangs, la désillusion de leurs sbires, et de leurs perdition caresser l’âpreté d’un monde sans femme providentielle. Et pourtant, malgré la multitude de tentatives à mon encontre, toutes furent vaines ; que ce soit les liens qui me tenaient ligotée s’effilochant, le sol sous mes ravisseurs s’affaissant, ce refrain sans réfreiner se répétait, radotait, rabâchait sans rafraîchir l’impétuosité de mes passions réfrénées. Quelle place pour la providence ? Quelle est la valeur de mon héroïsme, si chaque fois que l’impasse s’offre à moi des forces supérieures me tirent d’affaire ? La providence crée le providentiel, le providentiel s’évanoui face à la providence. Les années passèrent alors que cette histoire cyclique s’élançait sans s’amenuir. Les discours de propagande se propagèrent, et le cœur des auditeurs s’enveloppèrent de ce lyrisme romancé, jusque’à ce moment, insipide, curieux et malfaisant, où la gloire ne suffit plus, le contrôle devient une lubie plus alléchante ; nous portons tous dès l’orée de nos treize ans ce code en barre, imposé, au creux de notre main. Plus que du sang ou que notre ADN, c’est notre identité, notre permis de conduire, nos consommations, nos condamnations qui coulent dans nos veines ; rien n’est interdit, mais tout est observé : de tous ces nouveaux auriges, tous eurent la gloire, la richesse et le confort promis, mais c’étaient quand même des esclaves. Nous sommes tous ces auriges dont je te parle dans ce monde que tu découvres enfin, mais ce ne sont nos oripeaux et ce faste qui nous rendent libre. Alors que faire pour gagner la place qu’on me prête ? C’est à se demander si le monde serait en péril si personne ne devait le sauver. »
Las. Quels mots placer sur ce sentiment que je ressens : j’agis comme un corps étranger, avec un monde sur lequel agir. Je suis déroutée, seule. La gorge serrée, un sanglot bouillonne dans mes iris, comme une pression trop longtemps retenue ces trente dernières années, une patience accrue qui veut s’exprimer, et l’impression d’avoir quitté à jamais un monde qu’on aime et croire qu’on ne peut le retrouver : c’est juste différent. Une nouvelle place. Ici et maintenant, quelque chose à faire. Mais quoi ? Quelles actions mener, quand si peu d’espoir nous habite, et que notre premier interlocuteur dans cette plaine neuve, semble tout aussi désespéré. Daphné poursuit : « Si le monde voit en moi la libération, je ne sais qu’en faire. Comme eux, je suis de ces nouveaux auriges qui trouvent la plénitude comme l’est le vide qui s’emplit de rien, mais que c’est déjà beaucoup, et que ça lui suffit. Ici cachée, voilà que ma fortune je dissimule. Et ton sauvetage comme une infortune surprend comme tu arrives, alors que je croyais qu’enfin, rien ne pouvait plus me sauver ».
Un silence enveloppa la pièce jusqu’à ce que Daphné, toujours affalée sur les carreaux froids, acheva « Alors. Qui sauve qui ? ». Mon regard s’agrippa à son destin, fulmina de rage, de honte, il se fronça. J’élança une jambe encore bien engourdie en direction de mon scaphandre, toujours en pesanteur. Réinitialisation du procédé. Activation de la cryogénie. Fin du processus ? Réflexion sur l’éthique. Fin du processus ? insista la machine. Aucune date de fin.
Je me tournais vers Daphné : ce salut d’un monde qui s’était créé ses propres problèmes. Je l’invita à prendre place dans le scaphandre : elle était la source des maux, mais son sacrifice vers ce repos éternel était écrit, pour que de providentielle elle devienne providence. Existence couronnée de laurier. Daphné s’était levée avec douceur et calme, avait pris place dans le scaphandre. Le couvercle se referma, je l’épiais jusqu’à ne plus la voir. Soufflement des vérins. Claquement des verrous.
À présent, je me tourne vers le boulevard, vers ce monde vers qui je me dirige et qui m’appelle. J’agis comme un corps étranger, dans un système malade. Serai-je le poison ou le remède ?