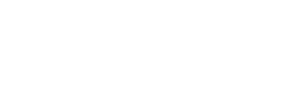J’étais assise à cette table en bois. Dehors, l’air est lourd et il fait plus de vingt-huit degrés. Il est 13h47. Les rainures de cette table, stries séculaires, fossés dans les vallées, rides sur un front d’enfant rendent mon écriture plus fragile. Et voilà que, sans peine, s’écoule un peu d’encre noire de cette pointe dorée. Dans l’air flottent des odeurs de café. Je n’aime pas les grandes villes. Mael est assis en face de moi, il a déjà creusé sa part de cake pavot-citron quatre coups de cuillère. Le glaçage blanc ressemble à de la neige fondue dans son assiette. Avec son index, il presse les petites miettes à la manière d’un jeune enfant. Cela fait 23 ans maintenant qu’il répète ce geste. Inlassablement. Et depuis qu’il voyage en train c’est encore plus fréquent. Bien sûr, il ne prend pas toujours une part de cake au citron, parfois il choisit un muffin aux myrtilles. D’autres jours c’est un carotte cake. Et parfois, lorsqu’il voyage le dimanche il prend une part de brownies au chocolat. Ceux qu’il préfère sont constellés de pépites qui les rendent plus croquants et particuliers. Mais peu importe le dessert, le jour où la saison, Édouard répète le même geste. Inlassablement. De façon méthodique et très soignée il tourne son assiette afin que le gâteau se trouve pile en face de son regard le plateau aligné avec les bords de la table. Il ouvre son livre ; aujourd’hui un traité d’économie. Le pose à côté de lui, hausse deux fois les sourcils pour signifier au monde (ou à lui-même, il ne le sait pas vraiment) qu’il aurait préféré lire autre chose. Il commence toujours par tapoter les plus grosses miettes, celles qui n’étaient à rien d’être des morceaux, celles que l’on peut encore pincer et qui laissent sur le pouce un film brillant. Ensuite, comme on remonte un fleuve, Mael remonte le bord droit de son assiette. Il tamponne, tamponne, tamponne frénétiquement les petits pétales noirs. Un sourire, absent jusqu’alors vient délicieusement habiller son visage. Ses pupilles grossissent à vue d’œil à tel point que l’on aurait cru un chat devant un bol de lait. Malicieusement, il s’affaire à déposséder l’assiette de tout son contenant et l’économie, qui était jusqu’alors peu enivrante, n’a plus d’intérêt quelconque. Quatre minutes et 20 secondes se sont écoulées. Cette valse frénétique maintenant terminée, Mael se laisse mollement tomber au creux de son fauteuil.
Je regarde par la porte vitrée. Le monde grouille de monde. C’était tout à fait marrant d’imaginer des histoires à ces inconnus. Il y a cette femme pas très grande et brune. Elle court une valise à la main et la main de sa fille dans l’autre. La petite ne doit pas avoir plus de quatre ans. Elle s’appelle Margot comme son arrière-grand-mère, drôle de coïncidence, elle est née le 27 mars. Sa mère, Marie Ortin, 32 ans, est née à Paris XIV. Son père épicier et sa mère libraire. Marie est toujours en retard. Elle a beau préparer ses affaires la veille, égrener ses listes comme des petits chapelets de bois. Rien n’y fait, Marie Ortin oublie toujours quelque chose. En courant dans le hall trois, elle passe à côté de deux machines à café, la troisième est en panne. Un distributeur automatique de billets et deux petites échoppes de savon. En courant dans le hall trois, elle heurte de plein fouet un jeune homme. Lode n’est pas français, il est venu faire des études de cinéma à Lyon – pas besoin d’expliquer pourquoi. Lode est intelligent et aigu. Il a toujours un bon livre dans la main ou dans la poche arrière de son pantalon. La plupart du temps, il porte des bateaux d’un bleu clair tirant vers le bleu de France. Hier, il avait commencé à lire le recueil de Schiele intitulé « Je peins à la lumière qui vient de tous les corps ». Un livre comme Lode les aime : impératif, qui touche du doigt l’éternelle difficulté du social bouleversant d’une tendresse astucieusement dissimulée. Lode semble souvent froid et distant et au fond c’est un peu le cas. Sociable d’abord par obligation, il se targue d’avoir toujours le mot qu’il faut. Si il avait été un fruit, ç’aurait été un citron. Les glaçons ont presque entièrement fondu dans mon gobelet de café format américain. En tournant la tête du côté opposé, j’avais vu sur le parc Jeanne Lanvin. Elle était là assise sous les marronniers. Ces longs cheveux blonds étaient comme des tapis d’or aux champs de blé. Elle les avait relevés avec deux petites pinces noires et pourtant, une mèche tombait follement sur son œil droit. Et le vent s’amuse à la balayer : Elizabeth. Elle portait une robe blanche avec de grandes fleurs bleues. Là assise sous les arbres, elle s’émerveille aussi. Sa bouche avait la couleur des vins crétois et les plis de sa peau sentaient les amandes et le romarin. La terre sous ses pieds prenait le goût du soleil et le soleil dans ses yeux avait la profondeur de la mer. Elle avait des mélodies de cités grecques si bien qu’il était aisé de se perdre dans le dédale de ses paroles dix fois millénaire. Elle était sous les marronniers, lancinante. Dans ses yeux, les siècles semblaient avoir passé sans encombre, les tournesols avaient poussé, s’étaient tournés et avaient dépéri. Et elle, du haut de sa fragile vingtaine : elle était là.
J’en étais à la dernière gorgée de mon café, jetais le gobelet dans une poubelle, prenais les escaliers qui me faisaient face. Tournais une fois à droite et arrivais sur la voie B. Je m’assois : fauteuil 92, là, je sors mon stylo et commence à écrire sur une table en bois. J’aime les tables en bois, le monde et sa multitude. Il est 13h 59. Je ne sais pas où je vais.